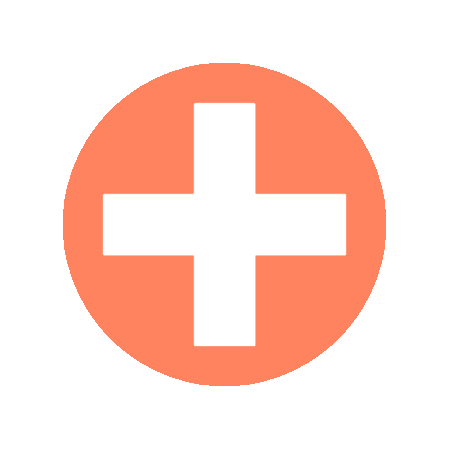Nous avons rencontré Lölja Nordic, une jeune opposante russe en exil, fin juillet au camp antifasciste dans le sud de la Carinthie, près de Zelezna Kapla/Bad Eisenkappel. Cette année, le camp s’est déroulé au mémorial de la résistance contre les nazis de Peršmanhof et a été pris d’assaut par les forces de police pour des raisons fallacieuses. Lölja est active au sein du mouvement féministe antiguerre The Feminist Anti-War Resistance.
Archipel: Lölja, tu viens de Saint-Pétersbourg et tu étudies actuellement à Vienne. La ferme Peršman n’est pas vraiment sur ton chemin, que représente cet endroit pour toi?
Lölja: Je suis allée pour la première fois au camp Antifa en 2024, avant cela, je n’avais jamais entendu parler de cet endroit et je ne savais rien de la résistance des Slovènes de Carinthie. Je ne connaissais pas l’importance de la lutte des partisan·nes pendant la Seconde Guerre mondiale. Ici, au musée, j’ai beaucoup appris, j’ai fait des recherches supplémentaires et je suis étonnée, voire profondément impressionnée par tout cela. Quand j’ai appris que le camp antifasciste avait lieu chaque année, j’ai été ravie de venir. En tant que féministe et antifasciste engagée dans la résistance active contre le fascisme russe, le rôle majeur des femmes dans la résistance m’a immédiatement interpellée.
Helena Kuchar-Jelka [une partisane slovène de Carinthie, ndlr] a toujours affirmé que la résistance s’exerçait au quotidien et n’avait pas grand-chose à voir avec l’héroïsme. Qu’en penses-tu?
Je partage tout à fait son point de vue. C’est une perspective très féministe. Dans un monde organisé de manière patriarcale, imprégné d’une masculinité toxique, la résistance est souvent définie par des actions radicales, des manifestations, un militarisme héroïque; rarement par des activités quotidiennes, souvent peu spectaculaires, mais pourtant si essentielles. Pour moi, la résis-tance couvre un large spectre, dont l’aspect héroïque du combat contre les nazis ou la police sur le front n’est qu’une infime partie. Nous devrions plutôt concentrer notre attention sur l’éducation et la sensibilisation. Nous devrions accorder plus d’importance à la diversité culturelle, au travail de soin, à la coopération et à la cohésion sociale, en particulier pour les personnes politiquement et socialement vulnérables. D’après mon expérience en tant que militante politique, cette routine quotidienne repose principalement sur les épaules des femmes. C’est un travail invisible et ennuyeux, mais qui est indispensable et doit être fait.
Je constate que les hommes engagés dans des mouvements politiques, même dans la gauche radicale, font cette distinction entre militantisme et travail quotidien. C’est aussi pour cette raison que je suis féministe, car il ne devrait pas y avoir de hiérarchie entre les domaines d’activité. Le travail quotidien est invisible, car l’histoire raconte les grands noms et les actes héroïques de la résistance, mais pas ce qui en est le fondement, à savoir le travail en coulisses. Encore un lien avec Jelka. C’était une femme sans instruction particulière, issue d’un milieu modeste. Les temps étaient difficiles et la présence des nazis oppressante. Les services de messagerie ou l’approvisionnement des partisan·nes étaient très dangereux, non seulement pour elle-même, mais aussi pour ses enfants.
Ici, en Occident, on entend dire qu’en Russie, toute opposition est impossible. Comment vis-tu cela?
Le régime de fer de Poutine ressemble de plus en plus à une dictature, les manifestations dans la rue ne sont plus possibles. Nous avons organisé plusieurs manifestations qui ont abouti à l’emprisonnement de nombreuses personnes, à une répression sévère, à des actes de torture et même à des meurtres. La dernière vague de grandes manifestations de rue a eu lieu en 2022 contre l’invasion de l’Ukraine. Dans plusieurs villes, des milliers de personnes ont manifesté, bien qu’elles fussent conscientes du risque. Il y a eu des arrestations massives et la répression s’est encore durcie. Nous avons connaissance de 2000 prisonniers politiques, mais le nombre réel est certainement plus élevé, car certain·es n’ont pas accès aux réseaux sociaux, sont peut-être empri-sonné·es quelque part dans une petite ville et personne ne sait qu’iels sont des prisonnier·es politiques.
En raison de la brutalité de la police, l’opposition a dû entrer dans la clandestinité. L’opposition en Russie ressemble désormais davantage à une résistance partisane. La lutte contre le régime se déroule en secret: agitation contre la guerre, distribution de tracts, contournement des ordres de mobilisation, rapatriement légal des soldats du front. Beaucoup ont été contraints de s’engager dans l’armée. Des centaines de milliers de personnes ont été déportées par l’armée dans différentes régions, où elles dépendent de l’aide humanitaire ou ont besoin de soutien pour retourner en Ukraine. Tout cela est organisé par des citoyens russes dans le cadre de mouvements populaires.
La résistance consiste également à prendre soin des nombreux prisonniers politiques. Le régime veut qu’ils soient invisibles, que leur nom soit oublié, qu’ils croupissent misérablement en prison. Les citoyens russes publient leurs histoires et collectent des fonds pour payer des avocat·es. Lorsque vous êtes condamné à 20 ans de prison, il est particulièrement important d’avoir un·e avocat·e, car iel est souvent le seul à pouvoir obtenir un droit de visite, vous voir et ainsi établir un lien avec le monde extérieur. Les prisons russes sont très coûteuses, on ne peut pas y survivre sans argent. La nourriture, les médicaments, les vêtements propres, tout ce qui est nécessaire à la vie quotidienne, tout cela doit être financé par des collectes d’argent ou par la famille. Si cela m’arrivait, je n’aurais aucun soutien de la part de mes proches. Un aspect de la résistance est aussi la survie des prisonnier·es. Tant que quelqu’un s’en occupe, qu’iels ne sont pas oublié·es, iels ont plus de chances de ne pas être torturé·es à mort.
Des centaines de personnes ont également mené des actions partisanes plus radicales: elles ont par exemple incendié des bureaux de mobilisation de l’armée et détruit des documents. Cela a retardé la conscription de nombreux soldats, car nombre de structures officielles ne sont pas en-core numérisées. Des voies ferrées servant à approvisionner le front en équipement militaire ont été détruites, des trains entiers ont été perdus, ce qui a ralenti la machine de guerre. Heureuse-ment, la plupart des acteur/trices n’ont pas été pris·es. Mais certain·es ont tout de même été arrê-té·es, condamné·es à 20 ou 25 ans de prison et gravement torturé·es.
En dehors de la Russie, cette résistance est malheureusement méconnue, malgré les risques énormes qu’elle comporte. Quand je lis les journaux ici, ils disent que tout le monde soutient Poutine. Probablement parce que nous ne pouvons pas fournir de superbes images de violentes batailles de rue avec la police.
On nous dit que la société civile russe subit un lavage de cerveau. Nous voyons des images d’hommes belliqueux qui gagnent beaucoup d’argent en servant au front. Tu dis que le mouvement féministe s’est considérablement développé. Comment pouvons-nous nous l’imaginer?
Je pense que dans tout conflit armé, il y a des gens qui tirent profit de la guerre ou qui appartiennent à un milieu masculin agressif et toxique qui prend simplement plaisir à tuer les autres. À mon avis, cela n’a rien à voir avec un pays ou une nationalité en particulier. Lorsque la mobilisation a commencé, les rues des grandes villes étaient désertes. Même les partisans de droite, convaincus de la nécessité de la guerre ou les partisans de Poutine ne voulaient pas combattre. Je n’étais déjà plus en Russie, mais tous·tes mes ami·es m’ont rapporté que les hommes se cachaient, pour de bonnes raisons. À partir de 2022, plus de deux millions de personnes aptes au service militaire sont parties à l’étranger et ne sont jamais revenues. Indépen-damment de leurs convictions politiques, ils ne voulaient pas s’enrôler. À mon avis, la plupart des Russes ne veulent pas se battre.
Notre collectif féministe contre la guerre est né avec l’invasion à grande échelle. Des groupes de différentes régions de Russie se sont réunis, nous avons participé à toutes les actions, les mères et les épouses de soldats contraints de partir au front se sont regroupées, des proches ont retiré leurs fils et leur mari de l’armée malgré les intimidations massives du gouvernement. Mais pour nous, il est tout aussi important de souligner qu’outre le conflit militaire, il est également question d’égalité des sexes. En temps de guerre, les femmes sont les premières à être réduites au silence et la violence sexiste augmente. Selon les statistiques, la violence à l’égard des femmes a considérablement augmenté en Russie depuis le début de la guerre. Dans les situations de crise, dans un climat national où la violence est justifiée et tolérée, ce sont les femmes qui en sont les premières victimes. Cet effet est scientifiquement prouvé. C’est pourquoi nous affirmons qu’il ne s’agit pas seulement des répercussions sur l’Ukraine, mais aussi de notre société, de la sécurité des femmes et des enfants. Nous parlons beaucoup de ce que cela signifie lorsque le gouvernement russe donne aux crimi-nels le choix entre purger leur peine ou servir au front. Il s’agit de personnes condamnées à des peines de 6 à 10 ans pour meurtre, viol ou autres délits graves. Ils signent un contrat et, s’ils ont la chance de survivre quelques mois au front, ils reviennent en tant que personnes «libres», leur casier judiciaire est de nouveau vierge. Il y a eu plusieurs cas où ces criminels ont récidivé, ont de nouveau commis des meurtres ou des viols. Puis ils repartent pour un certain temps à l’armée et tout recommence. C’est un cercle vicieux infernal et extrêmement dangereux pour notre société.
La Russie est un pays immense, comment organisez-vous la coopération interrégionale jusqu’à la périphérie?
Bien que la Russie ait une superficie géographique énorme et compte 140 millions d’habitant·es, des manifestations contre la guerre ont eu lieu partout, de l’Extrême-Orient au Sud et au grand Nord. Elles ont largement dépassé les métropoles de Moscou et Saint-Pétersbourg. Nous avons observé que la résistance était particulièrement vive dans les républiques composées de minorités ethniques et d’autochtones. Ces peuples ont été colonisés de manière brutale à plusieurs reprises, d’abord par l’Empire russe, puis à nouveau à l’époque de l’Union soviétique. Ils ont subi le racisme et l’oppression, ce qui s’est à nouveau manifesté lors de la mobilisation. En effet, beaucoup plus de soldats ont été enrôlés ici qu’à Moscou ou Saint-Pétersbourg, où la population est majoritairement «blanche». Le gouvernement partait du principe que ces «Moscovites blancs» avaient davantage de ressources pour se soustraire à la conscription et que personne ne se souciait de toute façon des autres. La population russe ne vit pas seulement dans les grandes villes, mais se compose également de nombreux peuples autochtones et de différentes minorités ethniques qui, ensemble, sont très nom-breux et constituent une grande partie de la résistance contre le régime de Poutine. Malgré toutes les menaces, ils ont continué à protester avec acharnement, même après l’invasion totale.
Ces dernières années, la Russie a mené des guerres sur plusieurs fronts. Les gens ne sont-ils pas fatigués de tout cela?
Tout le monde est fatigué, les Russes comme les Ukrainien·nes, car la guerre fait rage depuis plus de trois ans. En réalité, elle a commencé dès 2014. C’est une longue expérience traumatisante, sans issue en vue. Au sein du mouvement féministe antiguerre, nous sommes très inquiètes à l’approche des négociations pour un cessez-le-feu. Nous sommes tout à fait d’accord avec nos camarades ukrainiennes et le disons clairement au monde entier: un cessez-le-feu ne signifie pas la paix. Tant que le régime de Poutine existera, il n’y aura pas de paix. Bien sûr, nous voulons que les armes se taisent, mais même si cela se produit, il n’y a absolument aucune raison de se détendre. Tout dépendra des conditions dans lesquelles les négociations se dérouleront. Si ce sont celles de Poutine, ce sera terrible. Non seulement pour l’Ukraine, mais aussi pour l’Europe et le monde entier.
Qu’est-ce que cela signifie pour les populations des territoires actuellement occupés par la Russie?
Lors de l’occupation de la Crimée, le régime a complètement anéanti toutes les activités des mouvements de défense des droits humains, de la démocratie, de l’environnement et d’autres mouvements de la société civile. Il n’y a absolument plus rien à faire, tout est étouffé par la poigne de fer du gouvernement. Les habitant·es sont considéré·es comme une menace par les occupants. Ceux-ci savent très bien qu’une grande partie de la population ne veut pas coopérer.
La première chose que Poutine a faite après l’occupation a été de bloquer toute activité dans la région et d’opprimer massivement les habitant·es. De nombreux/ses militant·es se sont retrouvé·es en prison. Parmi le grand groupe des Tatars de Crimée, qui se sont particulièrement opposés à l’occupation, beaucoup ont été emprisonnés et torturés. Fuir ou aller en prison, voilà ce qui attend des milliers de personnes dans les territoires occupés. Il ne faut pas oublier ces gens!
Comment peux-tu rester en contact avec les gens en Russie depuis ici? Les Russes en exil soutiennent-ils la résistance?
La société civile russe, les opposant·es clandestin·es, les personnes qui ont dû fuir et ne peuvent pas s’exprimer publiquement ou qui, comme moi, vivent à l’étranger et peuvent s’exprimer publiquement, nous sommes en contact quotidiennement par-delà les frontières et travaillons ensemble. Bien sûr, nous utilisons Internet, organisons des conférences Zoom, avons nos chats protégés et parfois nous nous rencontrons dans des pays tiers ou parvenons à nous réunir en secret.
Ici, dans un environnement plus libre, nous profitons de l’occasion pour informer sur ce qui se passe réellement en Russie et soutenir nos camarades qui y vivent encore. Dès le début, l’une des stratégies de la machine de propagande a été d’attiser la discorde entre les personnes en exil politique et celles restées au pays. Elle continue d’essayer, mais pour l’instant, nous travaillons très bien ensemble.
Tu dis que les luttes politiques sont liées entre elles, par exemple le mouvement féministe et le mouvement pour le climat. En Autriche aussi, la situation devient plus difficile. Que devrait comprendre la population autrichienne?
Le régime de Poutine manipule largement l’Autriche. J’ai été choquée d’apprendre comment le Kremlin a étendu son influence pendant des années par l’intermédiaire du FPÖ et des politiciens de droite, sans parler de l’accord sur le gaz. Je trouve encore plus effrayant que la plupart des Autrichien·nes n’en aient pas conscience. L’Autriche, un pays au cœur de l’Europe, revêt une importance stratégique considérable pour Poutine. Les Balkans, la République tchèque, la Slovaquie et la Hongrie forment déjà un bloc pro-russe. Partout, Poutine a joué un rôle pour aider les gouvernements nationalistes de droite à s’imposer. L’Autriche serait pour lui une extension bienvenue de sa sphère d’influence contre le reste de l’Europe occidentale. C’est précisément son objectif géopolitique et, comme nous le voyons, il y parvient très bien. On sait que des agents pro-russes ont infiltré les structures du gouvernement autrichien. L’Autriche se présente certes toujours comme un État neutre, mais les politiciens des partis de droite ont des contacts personnels au Kremlin. Des liens financiers persistent également, même s’ils sont un peu plus dissimulés. Tout cela est très inquiétant. (...)
Entretien réalisé par Gabi Peissl, FCE-Autriche
*Voir Archipel 350, septembre 2025, «Agression policière au musée de Persmanhof».