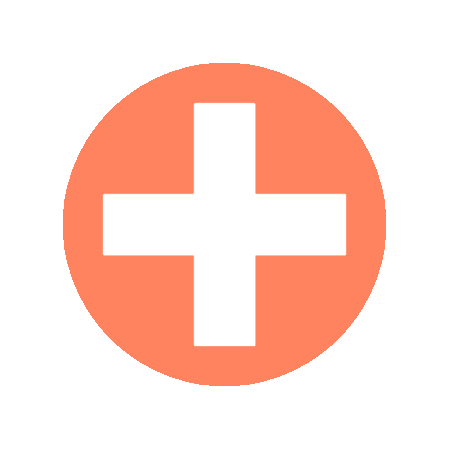Fin juillet, l’unique banque palestinienne de semences en Cisjordanie, l’un des fondements discrets de la résistance palestinienne, a été attaquée et détruite par les forces armées israéliennes – une nouvelle attaque contre un projet vital, contre une infrastructure de souveraineté alimentaire en Palestine. Fuad Abu Saif, directeur de l’UAWC – Union des comités de travail agricole, nous donne quelques clés pour comprendre cette attaque.
Sur les vastes collines des montagnes d’Hébron, un projet discret mais essentiel se développe depuis plus d’une décennie. La Banque de semences patrimoniales palestinienne, créée en 2010, est une initiative unique qui allie engagement scientifique, préservation culturelle et résilience populaire. Sa mission était simple mais extrêmement importante: collecter, préserver et multiplier les variétés de semences traditionnelles qui nourrissent depuis longtemps les communautés palestiniennes et ont façonné l’identité agricole du pays.
Le 31 juillet 2025, cette continuité a été violemment interrompue. Une unité clé de la banque de semences, son centre de multiplication des semences, a été démoli par les forces militaires israéliennes opérant dans la zone «C»[1] de la Cisjordanie occupée. L’attaque a entraîné la destruction d’infrastructures essentielles, notamment des systèmes d’irrigation, des équipements de contrôle et des registres techniques. Les parcelles cultivées, qui abritaient quinze variétés locales estivales, se sont retrouvées sans eau ni systèmes de surveillance, et la production de semences de la saison a été compromise. L’importance de cet événement réside dans la structure qu’il visait. L’unité de multiplication était une pierre angulaire fonctionnelle des opérations de la banque, chargée de produire les semences qui constituent la base d’un système alimentaire autonome et adapté au climat en Palestine.
Une vision ancrée dans le terroir
La banque de semences a été conçue pour répondre aux vulnérabilités structurelles de l’agriculture palestinienne: dépendance croissante vis-à-vis des semences importées, augmentation des coûts pour les agriculteur/trices et disparition des variétés traditionnelles inadaptées aux modèles industriels. Au fil des ans, son équipe a rassemblé et répertorié plus de 80 types de semences locales, légumes, céréales, légumineuses et plantes médicinales, les conservant à la fois physiquement et numériquement, et dans certains cas, les sécurisant à l’échelle internationale grâce à des dépôts dans la réserve mondiale de semences de Svalbard.
Le travail s’est étendu bien au-delà de la conservation. La banque a fonctionné comme une institution agroécologique, offrant des formations aux agriculteur/trices, collectant des données sur le terrain et renforçant les capacités des communautés en matière de sélection et de conservation des semences. Ses résultats ont permis à plus de 500 agriculteur/trices de cultiver chaque année des plantes adaptées aux conditions locales, résistantes à la pénurie d’eau et au stress climatique.
En 2025, l’unité de multiplication a revêtu une importance particulière. Après deux années consécutives de sécheresse sévère, au cours desquelles les précipitations ont atteint moins de la moitié de la moyenne annuelle, les régions agricoles pluviales du pays ont connu une forte baisse de productivité. Dans ces conditions, la disponibilité de semences adaptées aux conditions locales est devenue plus qu’une préférence, elle est devenue une nécessité.
Une attaque aux implications structurelles
La démolition ciblée de l’unité de multiplication n’est pas un incident isolé. Ces dernières années, les infrastructures agricoles palestiniennes ont été confrontées à des menaces récurrentes, allant de la violence des colons à la destruction de serres et de réseaux d’approvisionnement en eau. À Gaza, plus de 85 % des terres agricoles ont été rendues inutilisables lors des offensives militaires de 2023 et 2024. Dans toute la Cisjordanie, les restrictions d’accès à la terre et à l’eau sont systémiques.
Ce dernier événement aggrave la fragilité préexistante du secteur agricole. Les dommages causés à l’unité de multiplication risquent d’entraîner une pénurie importante de semences pour la saison à venir, en particulier pour les agriculteur/trices des zones arides qui dépendent d’une sélection précise des semences. Cela perturbe également l’intégrité du suivi technique et de la documentation sur les semences, éléments essentiels à toute stratégie d’adaptation écologique à long terme.
La perte s’étend aux dimensions culturelles et historiques. Plusieurs des variétés de semences touchées sont propres à la Palestine, liées à des géographies et à des systèmes de connaissances spécifiques. Leur culture s’inscrit dans une pratique plus large qui soutient les traditions culinaires, l’équilibre écologique et l’identité locale. L’unité de multiplication jouait un rôle central pour garantir que ces variétés ne restent pas des artefacts, mais continuent à évoluer entre les mains des agriculteur/trices.
Souveraineté et architecture agricole
Au fond, la banque de semences représente une infrastructure de souveraineté. Elle rétablit un aspect fondamental de l’autonomie: la capacité d’un peuple à choisir, cultiver et maintenir ses propres systèmes alimentaires, en se basant sur une logique écologique et des valeurs culturelles. Cette forme de souveraineté est matérielle et relationnelle, elle réside dans les semences, dans les connaissances, dans les routines de culture et d’échange. Dans des contextes d’occupation prolongée et de dépendance extérieure, ces infrastructures acquièrent une signification politique accrue. La banque de semences offre une alternative aux systèmes agricoles façonnés par les marchés extérieurs, les monopoles semenciers et la vulnérabilité aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement. Il s’agit d’un modèle de développement endogène, ancré dans le territoire, adapté au climat et responsable vis-à-vis des besoins de la communauté.
La destruction de l’une de ses unités centrales peut donc être interprétée comme une intervention structurelle visant à saper un modèle auto-organisé de production alimentaire. Elle compromet à la fois les résultats matériels et le système plus large de relations et de pratiques qui ont mis des années à s’établir.
Une responsabilité partagée
Les implications de cet événement dépassent les frontières de la Palestine. À l’échelle mondiale, la perte de la biodiversité agricole et de la souveraineté semencière est une préoccupation commune. Selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le monde a perdu plus de 75 % de sa diversité végétale au cours du siècle dernier. Des initiatives telles que la Banque de semences palestinienne font partie des rares initiatives qui inversent activement cette tendance en récupérant les variétés perdues et en les intégrant dans les systèmes agricoles actuels.
Le rôle de la banque de semences en tant que ressource scientifique, institution communautaire et projet politique reste intact. Les dégâts qu’elle a subis sont importants, mais pas irréversibles. Sa pérennité dépend non seulement de la résilience de son équipe et des agriculteur/trices qu’elle sert, mais aussi de la solidarité de celles et ceux qui comprennent les implications mondiales de la souveraineté semencière.
Nous invitons nos partenaires, les mouvements et les individus à travers l’Europe à prendre des mesures significatives. Cela inclut de nous aider à reconstruire l’unité endommagée par des contributions financières, de soutenir les campagnes de régénération des semences, d’organiser des événements de sensibilisation et des initiatives éducatives, ou même de se rendre en Palestine pour témoigner et s’engager directement auprès des communautés agricoles. La défense de l’autonomie agricole nécessite une responsabilité partagée.
Dans chaque acte de solidarité, aussi petit soit-il, se trouve une graine de justice!
Fuad Abu Saif, UAWC – Union des comités de travail agricole
- Division administrative de la Cisjordanie, sous compétence pleine et entière de l’État d’Israël, qui représente 60 % des territoires de l’ancienne Cisjordanie et qui concerne toutes les colonies israéliennes implantées en Cisjordanie et à Jérusalem-Est.