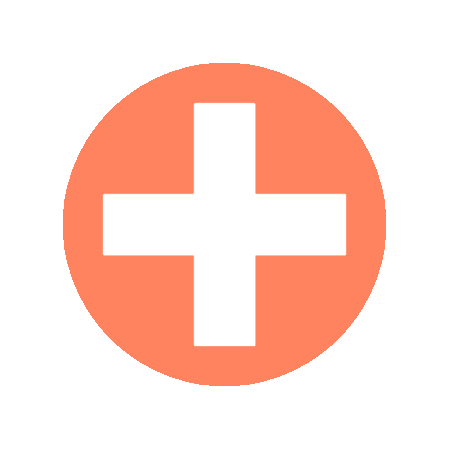Quand, le 1er janvier 1994, l’armée zapatiste lance son insurrection au Chiapas, après 70 ans d’hégémonie du PRI (Parti Révolutionnaire Institutionnel), la question des peuples originaires ou indigènes (re)devient centrale dans l’espace public mexicain. Et c’est dans la foulée de cette insurrection que des occupations de terres ont lieu au Chiapas mais aussi en dehors (Oaxaca, Guerrero)[1] par des organisations qui ne sont pas zapatistes.
Une grande dynamique de luttes indigènes et paysannes s’est amplifiée à cette période avec peut-être comme point d’orgue la création en 1996 du Congrès National Indigène (CNI), un es-pace qui voudrait coordonner les luttes indigènes sur tout le territoire mexicain. Tout ce mouvement venait continuer et renouveler des luttes historiques paysannes dont certaines remontent quasiment à la révolution mexicaine de 1910. Évidemment la répression n’a jamais cessé[2] ainsi que la militarisation de la société.
De 2006 à 2010
En 2006 le mouvement pour la défense des terres communales à Atenco contre la construction d’un aéroport et la commune de Oaxaca, malgré la répression brutale[3], renforcent les luttes pour les terres collectives et la dynamique de réappropriation de la culture et des droits indigènes.
À partir de 2006 la violence armée s’est exacerbée au Mexique sous l’égide du président Calderón (droite catholique) lorsqu’il a lancé «la guerre contre le narcotrafic». Il y a eu une explosion des morts, des disparitions et des massacres, toujours principalement dirigés contre les classes les plus précaires et marginalisées, c’est-à-dire bien évidemment les indigènes, mais aussi les pauvres non-indigènes ou les migrant·es originaires du centre et du sud américains, qui essaient de rejoindre les USA en traversant le Mexique[4]. «Depuis 2006, les effectifs militaires ont doublé, notamment grâce à l’accompagnement de conseillers militaires nord-américains et la dotation d’un matériel sophistiqué fourni par la Maison Blanche (hélicoptères Bell UH-1H, outils de détection, drones, appareils électroniques et informatiques), la formation de la gendarmerie mexicaine par la gendarmerie française, l’achat légal d’armes, par exemple à l’Allemagne, qui circulent ensuite de manière illégale dans les zones les plus dangereuses, comme ce fut le cas avec les M36 de Heckler & Koch retrouvés dans le Guerrero et le Michoacán.
L’armée opère aussi un changement qualitatif de l’intervention militaire par la militarisation de la société et l’élargissement des droits militaires dans la sphère civile, notamment pour faire des perquisitions sans mandat d’arrêt».[5]
Durant cette période, malgré – ou à cause de – cette confrontation directe avec l’État et ses supplétifs plus ou moins légaux, dans nombre d’endroits au Mexique les luttes pour la défense des terres collectives restent fortes et des initiatives surprenantes voient même le jour, telle la création ou plutôt le renforcement des polices communautaires; les premières ayant émergé dans les années 1990.
Les années 2010
Cette période voit à la fois le retour au pouvoir du PRI et une offensive libérale se renforcer avec différentes réformes de privatisation lancées ainsi que des projets d’infrastructures de grande ampleur, tel que le Projet Intégral Morelos (PIM)[6]. Ce sexennat du PRI, avec le président Peña Nieto, est aussi marqué par la continuité de la soi-disant «guerre contre le narcotrafic», et donc par une continuité ou un accroissement de la violence, entraînant une résistance acharnée des peuples indigènes dans différents endroits. Cette résistance se paie au prix fort parfois, comme le montrera la disparition des 43 étudiant·es de l’école normale rurale d’Ayotzinapa, le 26 septembre 2014…
En 2018, deux faits majeurs viennent bousculer les dynamiques de résistances et rébellions indigènes. Tout d’abord, la tentative de présenter une candidate indépendante et indigène à l’élection présidentielle a eut des effets contrastés. Le Congrès National Indigène, à l’initiative des zapatistes, a eu l’idée de tenter de présenter Marichuy comme candidate à la présidence, après d’âpres discussions et débats en interne. Cette candidature se voulait à la fois un pied de nez à la classe dirigeante – car il était clair que le CNI refusait la prise de pouvoir –, mais aussi l’occasion de fédérer un grand nombre d’initiatives, groupes, collectifs et associations autour de la dynamique de récolte des signatures[7]. Et s’il est vrai que cette candidature a généré une belle énergie et la création de collectifs, dont certains existent encore à l’heure actuelle et sont imaginatifs dans leurs luttes, cet appel du CNI a ravivé des désaccords déjà existants au préalable. Certains groupes ou communautés, farouchement opposé·es à la voie électorale, n’ont pas participé à la récolte des signatures, voire ont réduit leur engagement au sein du CNI. D’autres groupes ou communautés se sont plus reconnus dans cette initiative, et y sont allés pleinement en croyant à cette voie électorale. L’idée de cette candidature comme pied de nez n’a donc pas eu l’ampleur escomptée.
Et dans ce contexte arrive le deuxième fait majeur: l’arrivée au pouvoir d’Andrés Manuel López Obrador (AMLO), premier président dit de «gauche». Porté par la ferveur populaire, il a fait quelques réformes qui ont effectivement plu: augmentation du salaire minimum, doublement des retraites, augmentation ou création de bourses d’études ou de scolarisation, etc. Mais ces quelques miettes sociales se fracassent sur la grande idée d’AMLO: la 4e T, la quatrième trans-formation qui se veut un programme développementiste de grands projets visant à transformer profondément le pays[8].
Tout en poursuivant certains projets, comme le PIM, AMLO va initier le projet du train maya ou moderniser les idées anciennes de corridor transocéanique dans l’isthme de Tehuantepec[9]. L’isthme a déjà été défiguré par les parcs éoliens massifs construits depuis les années 1990. Le pouvoir parle pour ces projets de projets de «bien-être». AMLO utilise une rhétorique et une pratique du pouvoir que l’on peut taxer de populisme, entre sa conférence de presse matinale quotidienne ou la mise en place de pseudo-consultation des populations sur ces projets qui tous gangrènent des terres collectives. Et dans cette société déjà fortement militarisée, AMLO n’a rien trouvé de mieux que de confier la construction et la gestion des trains maya et transocéanique à l’armée ou à la marine, leur assurant ainsi une rente financière.
Une stratégie de division et de cooptation des mouvements de résistance indigène est mise en place pour affaiblir les communautés. Et quand cette stratégie n’est pas suffisante, la violence vient l’appuyer, comme l’a prouvé l’assassinat de Samir Florès Soberanes à Amilcingo (Morelos) le 20 février 2019. Lors de la campagne électorale de 2017, AMLO s’était opposé au projet de centrale géothermique que dénonçait Samir Florès, avant de retourner sa veste une fois élu… Il est un des responsables de cet assassinat, vu qu’il avait attaqué Samir Florès lors d’une de ses conférences de presse quotidienne et qu’il a sali sa mémoire après… La mort de Samir Florès a cassé la dynamique de résistance de la communauté, qui avait pourtant une belle histoire et une tradition de lutte qui remonte à l’époque de Zapata.
La cooptation de leaders indigènes a malheureusement fonctionné, comme le prouve le ralliement d’Ignacio Del Valle, leader historique d’Atenco, à la 4e T. Ces mouvements de cooptation liés aux désaccords internes au sein du CNI l’ont largement affaibli, et ont par conséquence affaibli les luttes indigènes dans tout le pays.
Le mouvement zapatiste
Une dynamique issue des peuples originaires, mayas en l’occurrence, a pourtant continué à se développer et à se renouveler durant toute la période décrite ici: c’est la lutte du mouvement zapatiste au Chiapas. Malgré toutes les trahisons (refus du gouvernement d’appliquer les accords de paix par exemple), attaques ou calomnies et malgré la mode politico-médiatique qui s’en est détournée (en partie à cause de leur refus de participer à la prise du pouvoir), le mouvement zapatiste reste d’une vigueur et d’une fraîcheur étonnante après plus de quarante ans d’existence et plus de trente ans de surgissement public.
Pendant plus de vingt ans, sur une superficie à peu près grande comme la Belgique, les zapatistes ont construit leur autonomie, développant l’éducation, la santé et l’agriculture tout en s’auto-gouvernant. Analysant constamment la situation de leur pays, mais aussi du monde[10], intervenant ponctuellement sur la scène politique mexicaine[11] puis se retirant pour continuer le chemin de la construction de l’autonomie, «envahissant» symboliquement l’Europe lors de la rencontre des résistances et rébellions avec leur voyage «Pour la vie» ou en organisant des rencontres de femmes, d’artistes, de scientifiques, le mouvement zapatiste a fait preuve tout au long des trente ans de sa vie publique d’une inventivité surprenante et d’une riche créativité.
Et ce ne fut pas la moindre des surprises d’apprendre que les zapatistes changeaient toutes leurs structures d’auto-gouvernement, l’année dernière. En effet, après un long processus d’analyse et de consultation interne (on parle de 10 ans), le mouvement a décidé d’abolir la structure antérieure de l’autonomie, Fuera (ou exit) les conseils de bon gouvernement (Junta de Buen Gobierno, JBG) et les MAREZ, (Municipio autonome rebelle zapatiste). Le mouvement a constaté différentes dérives dans cette organisation, quelques cas de corruption, mais surtout une dépendance trop grande, des pertes d’information et pour finir une certaine hiérarchie entre les JBG et les marez. Les zapatistes ont voulu abattre la «pyramide» du pouvoir qui existait chez elleux. Iels ont mis en place une nouvelle organisation plus horizontale à base de Gouvernement Autonome Local dans les communautés. Iels ont aussi lancé une initiative qui paraît ambitieuse, «le commun». Au travers du «commun», les zapatistes invitent toute personne, donc y compris les non-zapatistes (à l’exception des membres du crime organisé), à participer à la gestion du territoire pour pouvoir survivre à la Tempête qui vient et qui a déjà commencé, allégorie à la fois du changement climatique et de la déliquescence politique en cours.
Ces nouvelles initiatives sont présentées lors de différentes sessions de rencontres réparties sur une année entre décembre 2024 et janvier 2026. Il est trop tôt pour tirer des enseignements de cette nouvelle organisation, vu qu’elle a à peine deux ans. Ce qui est sûr, c’est que cette initiative donne de l’énergie et de la réflexion, du grain à moudre aux mouvements indigènes mexicains, ou aux mouvements émancipateurs où que ce soit dans le monde…
La dynamique des zapatistes ne se constate pas uniquement dans leur inventivité et leur réactivité, mais aussi dans la constitution même du mouvement. Lors des rencontres «Une partie du tout», du 3 au 16 août 2025 au caracol de Morelia, nous avons pu constater, outre une énorme mobilisation des bases d’appui zapatistes à ces rencontres (on parle de 3000 bases d’appui), une présence très forte de jeunes et de femmes, signe de la vitalité du mouvement.
Cédric, Radio Zinzine
- Le Chiapas, Oaxaca et le Guerrero sont trois États du sud du Mexique, très certainement les plus indigènes et les plus marginalisés par le racisme structurel des sphères du pouvoir mexicain.
- Massacre de Aguas Blancas, 17 paysan·nes assassiné·es au Guerrero en 1995; massacre d’Acteal, 45 indigènes tsotsils tué·es, majoritairement des femmes et des enfants, au Chiapas en 1997; massacre d’El Charco, 11 paysan·nes assassiné·es, au Guerrero en 1998; pour ne citer que les actes les plus sanglants et les plus embléma-tiques.
- Le Front des Peuples en Défense de la Terre, s’est constitué contre l’implantation d’un nouvel aéroport sur des terres communales au nord du Mexique. S’il a réussi a empêcher cette construc-tion, la répression a fait 2 morts, 217 détenu·es et torturé·es, dont 47 femmes violées par les forces de l’ordre. L’APPO, Assemblée populaire des peuples de Oaxaca, connue comme la Com-mune de Oaxaca a, lors d’une insurrection populaire, auto-gouverné la ville de Oaxaca pendant trois mois, sachant que le mouvement a duré au moins 6 mois (juin-décembre 2006). La répres-sion, dont les chiffres ne sont pas exactement connus, a fait au moins 9 morts et 216 disparu·es…
- Un exemple: massacre de 116 migrant·es à San Fernando, Tamaulipas en 2010.
- In Mexique, une terre de disparu·es, 19 Récits, 2 Enquêtes, 1 Portfolio, ouvrage collectif sous la direction de Sabrina Melenotte, Fondation de la maison des sciences de l’homme et Institut pour la Recherche et le Développement, 2021.
- Le PIM veut améliorer la fourniture électrique dans ce coin du Mexique au travers de deux centrales thermoélectriques, un gazoduc, un aqueduc et une ligne électrique. Tout ceci pour permettre l’implantation d’usines, entre autres automobiles.
- Pour pouvoir se présenter à l’élection présidentielle en tant que candidat·e indépendant·e au Mexique, il faut 866.593 signatures ou parrainages, dans 17 États, en 120 jours. La mise en place d’un système de smartphones dernière génération et de dispositifs demandant une bonne connexion internet pour la récolte de ces signatures a grandement handicapé les communautés les plus reculées. La totalité des signatures n’a pas pu être récoltée à temps.
- Si AMLO parle de quatrième, c’est qu’il y a eu déjà trois transformations: l’indépendance de 1810, la réforme (instaurant la séparation de l’Église et de l’État) de 1857 à 1861 et la révolution de 1910, ces trois événements ont été des ruptures violentes conclues par l’adoption d’une nouvelle Constitution.
- Le train maya est un projet d’infrastructure touristique qui traverse la péninsule du Yucatán et accède aux pyramides mayas les plus connues. Il s’accompagne de complexes hôteliers de luxe et d’autres infrastructures. Le projet de corridor transocéanique date du XIXe siècle. Celui mis en place par AMLO est une voie de chemin de fer qui traverse la partie la plus étroite entre les océans Pacifique et Atlantique pour doubler le canal de Panama et favoriser le transport de marchandises. Les différentes lignes de trains sont quasiment toutes construites, il ne reste plus qu’à transformer les ports de Salina Cruz et Coatzacoalcos pour recevoir les méga porte-containers.
- Par exemple, le mouvement zapatiste a organisé la seule manifestation d’ampleur, à ma connaissance, contre la guerre en Ukraine le 13 mars 2022 avec 25 à 30.000 participant·es dans six villes chiapanèques.
- Initiative de l’autre campagne, en 2006, contre les élections présidentielles mexicaines, par exemple.